Face au sepsis, une mobilisation collective avec bioMérieux
Sponsorisé par Biomerieux FrancePour la première fois, bioMérieux publie un livre blanc consacré au sepsis. Il met en lumière comment l’entreprise, en collaboration avec les professionnels de santé et la communauté scientifique, contribue à l’évolution des pratiques cliniques et à l’innovation diagnostique pour mieux prendre en charge cette urgence médicale.
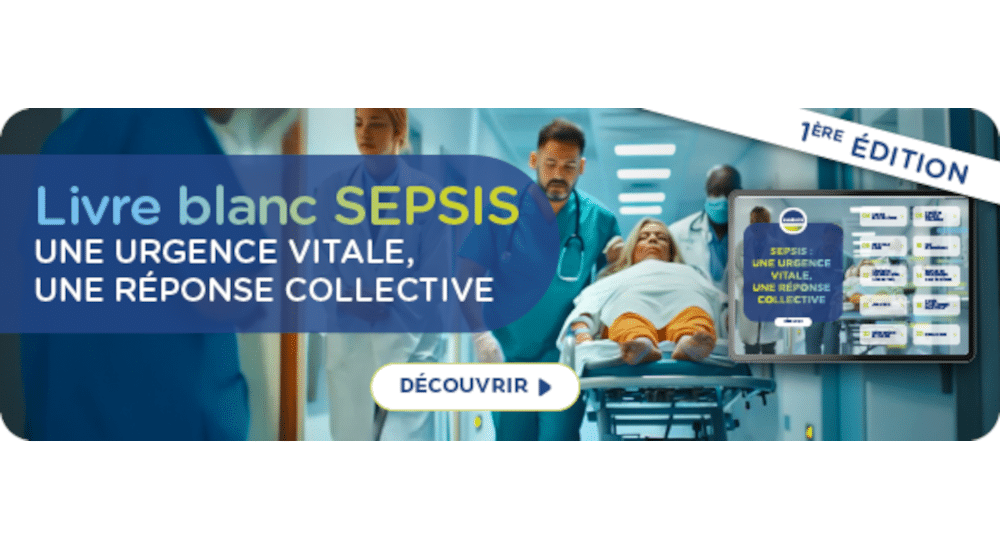
Decouvrez le Livre Blanc Sepsis
Le sepsis, un enjeu de santé publique mondial
A l’échelle mondiale, on estime que le sepsis, autrefois appelé septicémie, a touché 48,9 millions de personnes et été responsable de 11 millions de morts en 2017, soit environ 20 % de la mortalité globale¹. En Europe, 700 000 personnes en meurent chaque année, dont 57 000 en France², où le sepsis est l’une des premières causes de mortalité à l’hôpital : un patient hospitalisé sur quatre décède, et les survivants souffrent souvent de séquelles durables².
Au-delà du lourd tribut humain, son impact économique est considérable : en France, une hospitalisation pour sepsis coûte en moyenne 16 000 €², les patients en choc septique nécessitant des prises en charge intensives qui mobilisent des ressources importantes et pèsent sur l’organisation hospitalière.
Recommandations HAS 2025 : structurer le parcours de soins
Face à cet enjeu majeur de santé publique, la France ne disposait d’aucune recommandation récente couvrant l’ensemble du parcours de soins. La Haute Autorité de Santé (HAS), sollicitée par la Direction Générale de la Santé, a donc élaboré pour la première fois en 2025 des recommandations nationales pour la prise en charge du sepsis3, afin :
- d’améliorer la précocité du diagnostic,
- d’assurer la continuité et la qualité du parcours de soins,
- de limiter les séquelles fonctionnelles et neurocognitives à long terme
- d’impliquer davantage les professionnels de premier recours dans la détection précoce du sepsis.
Ces recommandations marquent un tournant : elles placent le sepsis sur le même plan organisationnel que l’AVC ou l’infarctus, en insistant sur la détection précoce, la continuité des soins et la coordination interprofessionnelle. Elles encouragent aussi le développement de filières locales intégrant hôpitaux, médecins libéraux et structures spécialisées, afin de réduire les retards diagnostiques et d’améliorer la qualité des soins.
IHU Prometheus : une réponse innovante à l’urgence du sepsis
Face à l’urgence mondiale du sepsis, une mobilisation inédite se déploie, en complément des recommandations nationales. Dans cette dynamique, bioMérieux soutient l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Prometheus, premier campus mondial dédié à cette urgence
médicale. Ce centre d’excellence, fruit de la collaboration entre chercheurs, cliniciens et industriels, combine recherche, innovation et soins pour améliorer concrètement la prise en charge. Objectif : développer une médecine de précision capable de détecter plus tôt le sepsis, d’adapter les traitements de manière ciblée et de sauver davantage de patients.
Partenaire privilégié de l’IHU, bioMérieux met à disposition ses solutions de diagnostic rapide, participe à la formation des équipes et soutient la recherche translationnelle. Dans ce contexte, le diagnostic dépasse le rôle d’outil technique et devient un levier stratégique de l’organisation hospitalière. Avec l’IHU Prometheus, c’est toute une dynamique collective qui se met en œuvre pour accélérer les progrès dans la lutte contre le sepsis.
bioMérieux, partenaire clé de l’innovation diagnostique
Si la prise de conscience de l’enjeu de santé publique que représente le sepsis progresse, le diagnostic reste le nerf de la guerre. L’expérience du CHU de Nîmes l’illustre : grâce à la combinaison des solutions bioMérieux BCID2 (identification rapide du pathogène et des gènes de résistance en < 90 min) et VITEK REVEAL™ (antibiogramme rapide en 4–6 h), les cliniciens peuvent désormais orienter et ajuster leur traitement dès les premières heures4. « Grâce à BCID2, on sait quoi traiter. Grâce à REVEAL™, on sait comment traiter. En six heures, on a déjà une décision thérapeutique ajustée », résume un réanimateur du CHU de Nîmes.
Au CH de Valenciennes, la mise en place du middleware MAESTRIA™ a permis de centraliser et d’exploiter les données microbiologiques de manière intuitive, pour optimiser la gestion des hémocultures et gagner en efficience5. L’intégration de ces outils dans les systèmes d’information hospitaliers facilite également la traçabilité, la recherche clinique et la formation continue des équipes, renforçant ainsi la sécurité des patients.
Des outils pour transformer la prise en charge
Lors des Journées Approche Syndromique 2024, les retours d’expérience du CHU Grenoble Alpes et des hôpitaux de Tarbes et Lourdes ont également confirmé l’impact de ces solutions sur l’organisation hospitalière. La mise en place du panel BIOFIRE® BCID2 a permis d’augmenter le taux de traitement optimisé à 12 heures à 82,4 % (contre 60,8 % avec la prise en charge standard), d’induire une modification thérapeutique rapide et adaptée dans 36 % des cas, et de réduire la durée moyenne de séjour de 18 jours (contre 20 jours).
Au-delà des chiffres, ces résultats montrent que l’intégration du diagnostic rapide au parcours patient permet d’adapter plus vite les traitements, d’améliorer la prise en charge, de soulager la pression sur les équipes soignantes et d’optimiser l’allocation des ressources hospitalières. Une évolution qui illustre pleinement le rôle central du diagnostic dans la lutte contre le sepsis et l’importance de poursuivre les efforts de formation et de sensibilisation pour transformer durablement les pratiques.
¹WHO – Sepsis fact sheet, 2017
²European Sepsis Report – European Sepsis Alliance, 2023
3Haute Autorité de Santé – Recommandations sur le sepsis, 2025
4CHU de Nîmes – retour d’expérience BCID2 + VITEK® REVEAL™, 2025
5Hospitalia #68 – « Au CH Valenciennes : pilotage intelligent avec MAESTRIA™ », 2025
 Se connecter
Se connecter

