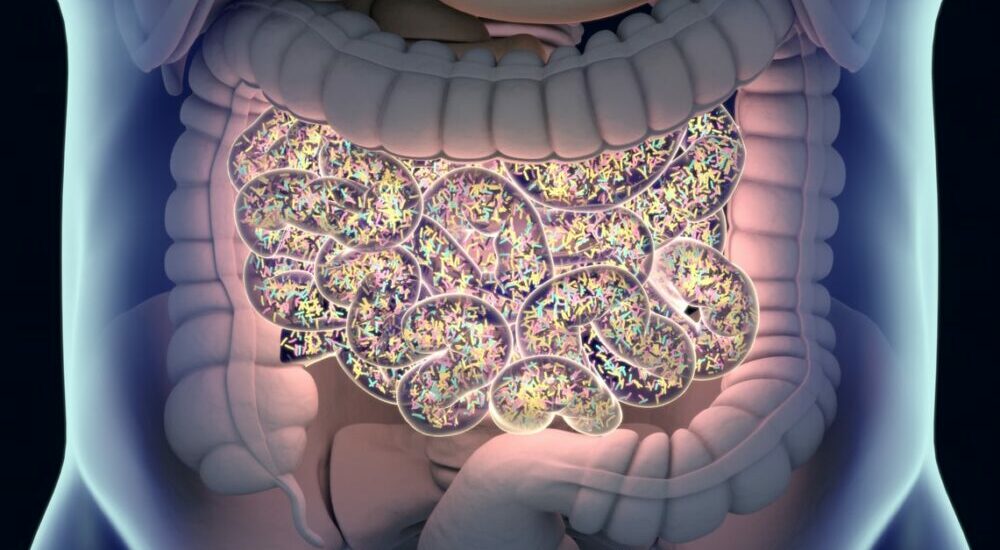Vaccins : pratiques et hésitations des médecins généralistes français
vaccination
Dans un article paru dans la revue Ebiomedicine, Pierre Verger (Unité Inserm 912) et ses collaborateurs présentent et analysent, dans un contexte de défiance vis-à-vis des vaccins, les attitudes et pratiques de plus de 1 500 médecins généralistes français.

La vaccination est le moyen de prévention le plus efficace pour combattre, voire éliminer, de nombreuses maladies infectieuses. Toutefois, ces dernières années, un accroissement d’opinions défavorables à cette dernière a été constaté dans la population générale française.
Face au scepticisme ambiant, qui contribue à l’insuffisance de certaines couvertures vaccinales, le médecin généraliste joue un rôle majeur en matière de prévention et d’information. L’enquête, menée par Pierre Verger auprès de 1712 médecins généralistes représentatifs du corps médical (Unité Inserm 912 « Sciences Economiques & Sociales de la Santé et Traitement de l’Information Médicale – SESSTIM »), entre avril et juillet 2014, a tenté de saisir les pratiques des médecins généralistes face à différentes situations vaccinales. Les résultats obtenus permettent notamment de mieux comprendre les facteurs de réticence ou, au contraire, de confiance, des médecins envers certains vaccins.
Les recommandations des médecins généralistes varient selon la situation
Une majorité des médecins fait plutôt ou tout à fait confiance au ministère de la Santé (8 médecins sur 10) ou aux agences sanitaires (9 médecins sur dix) pour leur fournir des informations fiables sur les bénéfices et les risques des vaccins.
Cependant, les recommandations des médecins généralistes varient selon la situation vaccinale : 83 % recommandent souvent, voire automatiquement, aux adolescents et jeunes adultes le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), mais seulement 57 % conseillent le vaccin contre les infections à méningocoques de type C aux enfants et aux jeunes, âgés de 2 à 24 ans, alors que celui-ci est inscrit dans le calendrier vaccinal. « Leur hésitation à vacciner pourrait ainsi renforcer celle des patients, et contribuer à l’insuffisance des couvertures vaccinales, en particulier celles des vaccins controversés. » estiment les auteurs de cet article.
Certaines incertitudes subsistent face aux risques et à l’utilité de certains vaccins
Si la quasi-totalité des médecins interrogés (96 %) sont confiants dans leur capacité à expliquer l’utilité des vaccins à leurs patients, ce chiffre tombe à 43 % lorsqu’il est question de parler du rôle des adjuvants, et de justifier leur utilisation. Par ailleurs, quand 54,5 % des généralistes se disent « très confiants » pour évoquer l’utilité des vaccins, ils ne sont que 26,2% à se montrer aussi assurés quand il s’agit d’évoquer leur sécurité.
A l’instar du reste de la société, les généralistes apparaissent sensibles aux controverses ciblant la vaccination et peuvent partager certaines des idées souvent brandies par les groupes anti vaccins. Ces derniers assurent ainsi fréquemment que les nourrissons seraient protégés contre un nombre trop important de maladies : une idée avec laquelle 53,1 % des médecins généralistes sont totalement en accord, tandis que 26,7 % se déclarent plutôt d’accord avec elle. Les groupes « anti vaccins » affirment aussi que certains vaccins recommandés par les autorités ne sont pas utiles ; une idée partagée par 73,6 % des médecins (38,3 % tout à fait d’accord et 35,3 % plutôt d’accord). Enfin, autre affirmation très fortement défendue par les groupes anti vaccins qui trouve un assez solide écho, néanmoins non majoritaire, chez les généralistes : près d’un tiers d’entre eux (32,8 %) considèrent que les adjuvants présents dans les vaccins sont susceptibles d’entraîner des complications à long terme.
Une acuité scientifique toujours forte sur des situations précises
Les doutes des médecins généralistes ne portent pas nécessairement, lorsqu’il s’agit de cas précis, sur les vaccins ayant été le plus mis en cause par l’opinion publique. Seulement 6 % des médecins interrogés considèrent probable, voire très probable, l’existence d’un lien entre le vaccin contre le papillomavirus et l’apparition de maladies neurodégénératives telles que la sclérose en plaques. Le vaccin HPV est toujours recommandé par 72,4 % des praticiens, soit plus souvent que la vaccination des nourrissons contre la méningite à 67,6 %. Seuls 11,7% des généralistes estiment possible le lien entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l’hépatite B.
Les « associations » qui paraissent les plus fréquemment possiblement causales aux généralistes sont celles qui ont effectivement fait l’objet d’études statistiquement concluantes : ainsi 24,3 % des praticiens jugent possible un risque de syndrome de Guillain-Barré après vaccination contre la grippe et 21,3 % un lien entre narcolepsie et utilisation du vaccin contre la grippe A(H1N1) en 2009.
Parfois des freins dans le maintien de la couverture vaccinale
Mais, de manière plus surprenante, une partie des médecins généralistes hésite à recommander des vaccins dont l’innocuité et l’efficacité n’est plus à prouver (vaccin contre le méningocoque C et la rougeole).
Ces résultats laissent apparaître que l’influence des différentes controverses et la « dangerosité » des maladies à prévenir n’ont pas nécessairement une relation directe avec la propension des généralistes à recommander ou non tel ou tel vaccin.
Ces hésitations ne touchent, pour le moment, qu’une part minoritaire des médecins généralistes, d’ailleurs variable selon le vaccin, mais constituent un frein supplémentaire dans le maintien d’une couverture vaccinale de la population suffisante pour la protéger contre des maladies infectieuses qui restent dangereuses.Si cette étude montre que les médecins généralistes font confiance aux autorités, elle souligne aussi leur besoin de formations et d’outils pour les aider à répondre aux patients hésitant à se vacciner.
Un grand débat national
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine, interrogée par mercredi 8 juillet par la commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre du futur examen du projet de loi de santé en première lecture, s’est dite favorable à un grand débat national sur la vaccination.
Interrogée par le sénateur socialiste Georges Labazée sur la question des adjuvants dans les vaccins, Marisol Touraine a rappelé qu’une étude menée par l’Inserm et financée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) était en cours. Les résultats sont attendus pour 2016-2017. Elle a aussi rappelé qu’elle avait chargé la député socialiste Sandrine Hurel d’une mission sur la question de la vaccination dont elle attend les préconisations pour le début de l’automne. « Je suis favorable, dès lors que cette mission aura été terminée, à ce que nous puissions avoir un grand débat national », a-t-elle indiqué.
Dans ce débat, « les professionnels de santé auront à s’exprimer, parce que ceux qui peuvent convaincre nos concitoyens, ce sont les professionnels », a-t-elle estimé.